Borre 1876 – Chapitre 5 – Les larmes du repentant



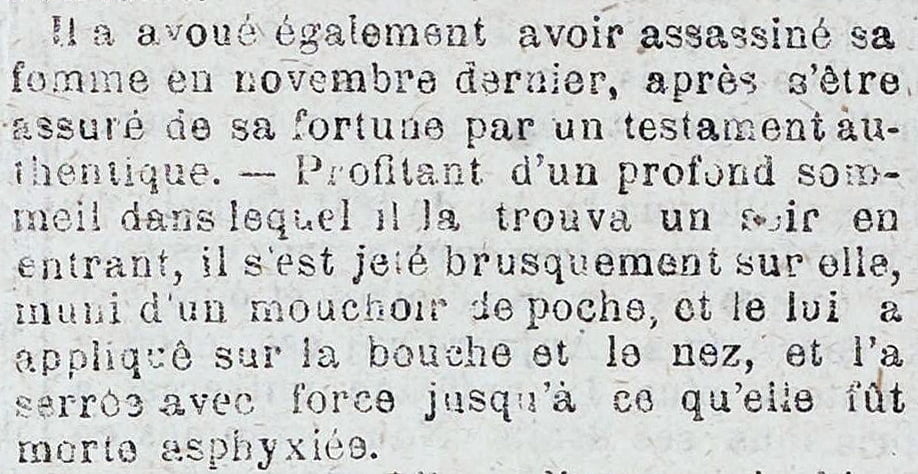

Mercredi 9 août 1876. Bureau du juge Demazière – 4ème interrogatoire (suite)
Le juge : Vous qui n’avez point hésité à tuer votre femme que tout le monde se complait à reconnaître comme ayant été la meilleure des femmes, n’auriez vous non plus été l’auteur de la mort subite, vous le savez, de votre tante Barbe Outier*, morte le 26 juin 1872, après vous avoir, à vous et à votre femme, le 6 Xbre 1870 par son testament légué tous ses biens meubles et immeubles ?
* Barbe Outier : née le 27 juillet 1800, célibataire, sœur de Reine Outier, la mère de Caroline Catoen
Louis Yden : Je n’ai aucune raison de vous cacher ce crime si je l’avais commis.
De la justice de ce monde je n’ai plus rien à attendre qu’un arrêt de mort. Je l’ai mérité et suis prêt à l’accepter. Plutôt il sera rendu plutôt je serai débarrassé de l’existence qui me pèse, depuis que j’ai commis ces trois crimes. Mais si je n’ai plus rien à attendre de la justice des hommes que la mort que je ne redoute pas, j’ai tout à craindre de Dieu que je redoute et ne voudrais à ce point de vue rien vous cacher de la vérité.
C’est à tort que la rumeur publique m’accuse de ce crime.
A l’époque où ma tante est morte je ne songeais en aucune façon à Pauline, en ce sens du moins qu’à ce moment je n’avais encore éprouvé pour elle aucun symptôme de passion.
Ma tante Barbe Outier demeurait quelques temps avant l’époque de son testament chez le Née Amélie Dehouck à Borre, elle y fut prise d’une maladie grave qui nécessitait beaucoup de soins que ma femme et moi lui donnâmes. Comme il était assez difficile pour nous d’aller chaque jour chez Amélie Dehouck donner à ma tante les soins que réclamait sa santé, nous l’engageâmes à venir chez nous. Elle le fit, mais comme la maladie trainait en longueur, un jour elle nous témoigna l’intention où elle était de faire don de tous ses biens à l’hospice de Steenvoorde, à la condition d’y pouvoir rester jusqu’à la fin de ses jours. Nous lui fîmes observer qu’elle ferait mieux de rester chez nous. Sauf à faire un testament en notre faveur, elle consentit à cet arrangement. C’est comme quoi nous avons été institués ses légataires.
Jamais, ainsi que je vous l’ai dit, je n’ai songé à donner la mort à ma tante. Quelle raison du reste eussè-je eu de le faire. Je n’étais point alors possédé de cette diabolique passion qui m’a entrainé si loin depuis.
Nous faisons alors observer au prévenu que la justice tient entre ses mains les moyens d’éclaircir bien des mystères et qu’en soumettant le cadavre de sa tante à l’autopsie, un homme de l’art pourrait sans difficulté arriver à découvrir la vérité.
Le prévenu répond avec le plus grand calme :
Je comprends très bien que des soupçons de toute nature planent sur moi, et j’ai commis assez de forfaits pour que vous puissiez me soupçonner d’en avoir commis d’autres. mais en dehors des trois crimes que je vous ai avoués je n’en ai point commis d’autres. Ce que j’ai fait je le dirai à mes juges comme à vous, mais je ne puis cependant point me reconnaître coupable de choses que je n’ai point faites.
A quelle époque pouvez vous faire remonter les premiers symptômes de la passion que vous dites avoir éprouvée pour Pauline Oudoire et qui vous auraient aussi, à votre dire, entrainé à tant de crimes ? Dans quelles circonstances et à quelle époque êtes vous entré en relation avec elle et sa famille? Qu’y a-t-il jamais eu, soit dans ses allures, soit dans celle de quelqu’un des siens, qui ait pu vous laisser supposer que votre amour pour Pauline était partagé ?
C’était dans l’été 1873, je venais d’aller voir une pièce de lin que j’avais achetée à un Né Benoit Gantois, cultivateur à Borre. En m’en retournant je m’arrêtai à la ferme Oudoire. Pauline et sa mère m’offrirent un verre de bière et comme cette dernière était sur le point de sortir de la salle où nous nous trouvions je me dis : « J’ai bien envie d’embrasser Pauline ». Je le fis et presque en même temps lui plaçai la main sur les genoux par dessus les jupes. Elle quitta la chaise où elle était assise et se plaça sur une chaise plus éloignée. J’allais me rapprocher d’elle quand elle me dit : « Chut, chut ..! ma mère va venir ». A ce moment, il m’a semblé voir que si j’avais osé être aussi entreprenant que d’autres, j’eusse pu aller plus loin et aussitôt je sentis comme un feu intérieur s’allumer en moi, feu qui alla toujours en grandissant, par les motifs que je vais vous dire et qui étaient, à mon avis, de nature à laisser croire que Pauline m’aimait et que sa mère pour le cas où j’eusse été libre aurait bien désiré voir un mariage se faire.
De ces motifs les uns précèdent la mort de ma femme et les autres la suivent.
Voici les premiers.
Un jour que Pauline buvait le café chez moi, voyant que je n’aimais pas le sucre, elle me dit devant ma femme : « Si nous étions mariés, les choses iraient bien, vous auriez tout le sucre et moi tout le café ».
Une autre fois elle me dit : « Vous avez une bien jolie maison, je l’habiterais volontiers ».
Une autre fois encore, c’est alors que je venais de faire un petit héritage après mon oncle Alexandre Yden, elle me dit : « Vous devez être maintenant bien à votre aise, et moi je le suis aussi, j’ai eu ce moment du chef de mon père une douzaine de mille francs, plus tard j’arriverai bien à en avoir une trentaine de mille« .
Les seconds, c’est-à-dire ceux qui ont suivi la mort de ma femme sont les suivants.
Le jour de l’enterrement, la veuve Oudoire se trouvait près de moi et se penchant à mon oreille elle me dit à trois reprises : « Louis, il faut maintenant venir souvent chez moi ». Dès l’après-midi j’y fus et alors elle me demanda comment étaient mes affaires. Je lui répondis : « Bien ». « N’irez vous pas voir chez le notaire ? », ajouta-t-elle, et comme je lui répondis que oui, elle me fit promettre de venir lui dire comme elles étaient.
Je fus en effet à Hazebrouck le lendemain matin et à mon retour m’arrêtai chez la veuve Oudoire à qui j’annonçai que j’héritais de toute la fortune de ma femme sauf le quart qui devait retourner à sa mère encore vivante. Je fus ce jour là reçu mieux que jamais car non seulement on m’offrit un verre de bière mais on me fit cuire un couple d’œufs.
Un peu plus tard, un jour que je causais avec la veuve Oudoire elle me dit : « Louis, n’allez toujours pas vous marier avec une personne qui n’a rien et non plus viser trop haut« .
Sur interpellation
Jamais ni avant la mort de ma femme ni depuis, je n’ai pris aucune liberté avec Pauline. Jamais non plus, elle ne m’a fait d’avances. Tout au plus si je l’ai embrassée une ou deux fois et quand cela m’est arrivé elle se retirait mais en riant.
Tous ces faits n’étaient ils pas de nature à me laisser croire que Pauline me rendait l’amour que j’avais pour elle et que sa mère eut été bien désireuse de nous voir nous marier ?
Quand, au tribunal de Dieu nous comparaitrons tous, vous verrez bien que je ne me trompe pas et que Pauline m’aimait.
Vous m’avez demandé aussi à quelle époque, non seulement j’ai été pris de passion pour Pauline mais aussi à quelle époque avaient commencé mes relations avec sa famille.
A cet égard je dois vous dire que je connais la famille Oudoire depuis que je suis à Borre, c’est-à-dire depuis 13 ans environ. J’ai souvent longtemps travaillé pour cette famille qui portait beaucoup d’amitié à ma femme, aussi aucun de ses membres ne venait guère à Borre sans s’arrêter chez moi du vivant de ma femme, soit pour boire une jatte de café soit pour causer un brin.
Lecture faite a dit y persister, a signé avec nous et le commis greffier et l’interprète.
Le lendemain, le juge décidait de revoir à nouveau Louis Yden et de tenter de le pousser dans ses derniers retranchements et de le faire craquer.
Jeudi 10 août 1876. Bureau du juge Demazière – 5ème interrogatoire
Partant de l’idée que vous avez émise que vous avez commis tous vos crimes pour Pauline et à cause d’elle, que c’est pour augmenter la fortune à lui offrir que vous avez tué votre femme, que c’est pour vous venger d’un affront qu’elle vous avait fait et aussi pour, en diminuant la fortune de Pauline, vous la rendre plus accessible que vous avez brulé sa ferme, qu’en présence de son attitude et de ses réponses qui, quelques jours après l’incendie, vous avaient fait croire qu’elle vous soupçonnait d’être l’auteur de ce crime, vous l’avez quittée avec l’intention bien arrêtée, dès ce jour, de la tuer parce que du moment où elle pouvait vous soupçonner d’être l’auteur de ce crime, il vous paraissait impossible qu’elle voulut de vous en mariage.
Partant dis-je, de cette idée, comment m’expliquez vous l’intention que vous avez indiquée à diverses jeunes filles notamment la demoiselle Verbaere la demoiselle Lebleu la demoiselle Degrendel et la demoiselle Debusche, toutes filles fortunées, de vous marier avec elles, à moins que votre intention ne fut, après avoir épousé l’une d’elles de lui faire faire un testament, puis de la tuer comme vous avez fait de votre 1ère femme, cela dans le but d’arriver à force d’argent à éblouir Pauline et à la décider à se donner à vous.
J’ai en effet, et je le reconnais, successivement demandé en mariage et cela avant l’époque où j’ai mis le feu à la ferme Oudoire :
1° Adelaïde Debussche
2° Julie Varbaere
3° Reine Degrendel
Dans aucune de ces trois maisons ni auprès d’aucune de ces trois jeunes filles je n’ai été mal reçu, loin de là, mais toujours l’idée de Pauline me revenant à l’esprit et tout espoir de l’épouser ne me paraissant pas encore perdu, je ne me suis point senti assez de force pour suivre mes progrès de mariage jusqu’au bout.
Après l’époque où j’ai mis le feu à la ferme Oudoire, je me suis adressé à la Née Reine Lebleu qui après m’avoir assez bien reçu, a fini par me dire que je ne devais plus retourner.
Mais jamais ni pour celles que j’ai demandées en mariage avant l’incendie de la ferme Oudoire, ni pour Reine Lebleu que j’ai demandé en mariage après, je n’ai éprouvé l’idée que vous me soupçonnez avoir eue.
Je suis un grand criminel, je le sais, et je ne m’étonne pas que de pareils soupçons puissent germer dans votre esprit, mais je ne puis mentir et le ferais cependant si je vous disais en les demandant en mariage que mon intention était de profiter, par leur mort, de leur fortune.
C’est en 1873 que s’est allumé en vous le feu d’une passion qui vous a conduit si loin. Par amour pour Pauline en l’an 1874, vous décidez votre femme à changer la forme du testament fait par elle en 1870 et vous obtenez qu’après la mort, au lieu de l’usufruit de tous ses biens, elle vous en abandonne la pleine et entière propriété. Pourquoi ? Parce que eu égard à la différence d’âge qu’il y avait entre vous et votre femme, vous pouviez espérer la voir mourir avant vous, et alors ayant en main toute sa fortune l’offrir à Pauline en lui demandant sa main.
A cette pensée qui n’est point encore criminelle, ne tarde pas à en succéder une autre. Celle de substituer votre main à celle de Dieu pour vous débarasser de votre femme. A ce moment il était de votre devoir, si la religion n’était point assez forte pour vous empêcher de donner suite à cette idée, de transporter vos pénates dans une autre commune, de fuir les regards de Pauline, de chercher par tous moyens de l’éviter.
Mais non ; loin d’écouter la voix de Dieu, ou simplement celle de la raison, vous recherchez les occasions d’entretenir vos passions pour Pauline et dix-huit mois durant, ne songer qu’à préparer avec une infernale habileté tous les moyens que vous croyez les meilleurs pour arriver à pouvoir tuer votre femme, sans qu’aucun soupçon ne plane sur vous.
Puis, descendant encore l’échelle du crime, le 1er forfait accompli, vous incendiez la ferme Oudoire et tentez d’assassiner votre maitresse.
Il faut avouer que votre conduite et de celles dont heureusement pour l’humanité, on trouve peu de trace et même dans les annales criminelles. J’espère que vous en comprenez aujourd’hui toute l’atrocité.
Tout ce que vous dites est vrai. Si j’avais écouté la voix de ma conscience qui avait de loin crié, lorsque je songeais à tuer ma femme, si j’avais écouté la voix de la sagesse qui me dictait de fuir les regards de Pauline, je n’eusse point fait les crimes que la société me reproche et que Dieu seul peut me pardonner, je serais aujourd’hui un homme heureux et ne pleurerais pas comme je le fais chaque matin lorsque la cloche de mon village sonne le jour et me rappelle mes forfaits.
Mais j’ai préféré caresser ma passion, j’ai recherché toutes les occasions qui me permettaient de sentir s’agrandir en moi le feu d’amour de chair qui me consumait pour Pauline. Je suis un grand criminel devant les hommes ; j’espère pourtant de la justice de Dieu ; car je suis profondément repentant des crimes que j’ai commis et ne saurais vous dire la joie que j’éprouve quand vous m’apprenez que Pauline Oudoire n’est pas morte. Car, inexplicable phénomène du cœur humain, je l’aime encore avec passion et pourtant, quand j’ai tiré sur elle je ne désirais qu’une chose, l’atteindre mortellement.

Les larmes que verse le prévenu et dont il accompagne sa réponse paraissent être des larmes d’un véritable repentir.
Avant de clore l’interrogatoire, nous observons au prévenu que sa présence pourra peut être nous être nécessaire lors de l’exhumation des cadavres de sa femme et de sa tante.
Le prévenu répond :
Je vous en supplie, Monsieur le juge, épargnez moi cette honte inutile. Sur la tombe de ma femme, comme sur celle de ma tante, se trouvent des croix de bois sans inscriptions. Je ne saurais certainement pas vous indiquer l’emplacement de leurs dépouilles, aussi bien que pourraient vous le dire le fossoyeur de Borre et son aide qui ont laissé glisser les bières dans la terre, et que Mr le curé et le chantre qui l’assistait.
Le cadavre de ma femme a été enseveli dans un drap, mais j’ignore s’il était marqué. On l’avait coiffée d’un bonnet blanc et la chemise dont on l’avait revêtue était blanche, mais je ne saurais dire si elle portait une marque, car de ses chemises, les unes étaient marquées C.C. en fil rouge et d’autres ne l’étaient pas.

Lecture faite a dit y persister, a signé avec nous, le commis greffier et l’interprète.
Le lendemain, vendredi 11 août 1876, le juge ordonna que soient pratiquées les autopsies des corps de Caroline Catoen et de Barbe Outier.


